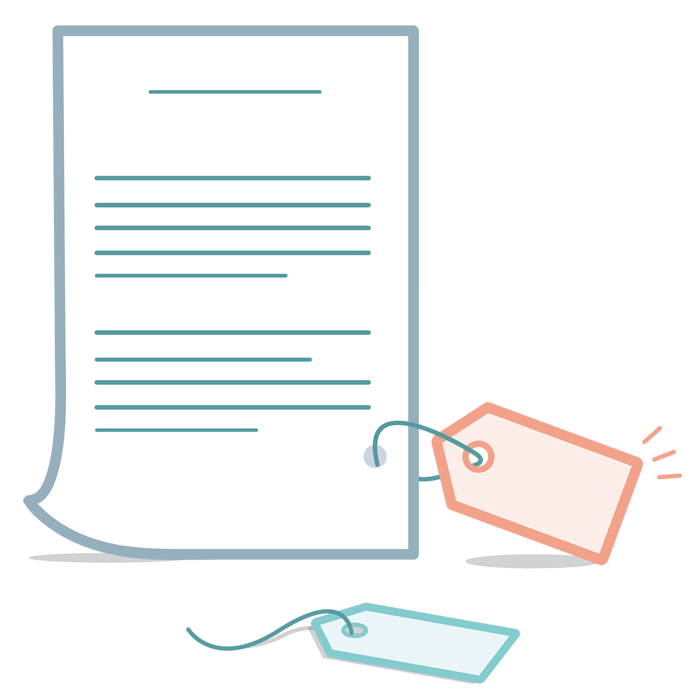Presentatie
critique littéraire
- Vak
- Instelling
ce cour est destiné au étudiant qui sont intéresser au littérature française au module de critique littéraire Narratologie La narratologie, science des formes narratives, classiquement fondée sur la distinction entre « récit », « histoire » et « narration », est une des disciplines...
[Meer zien]