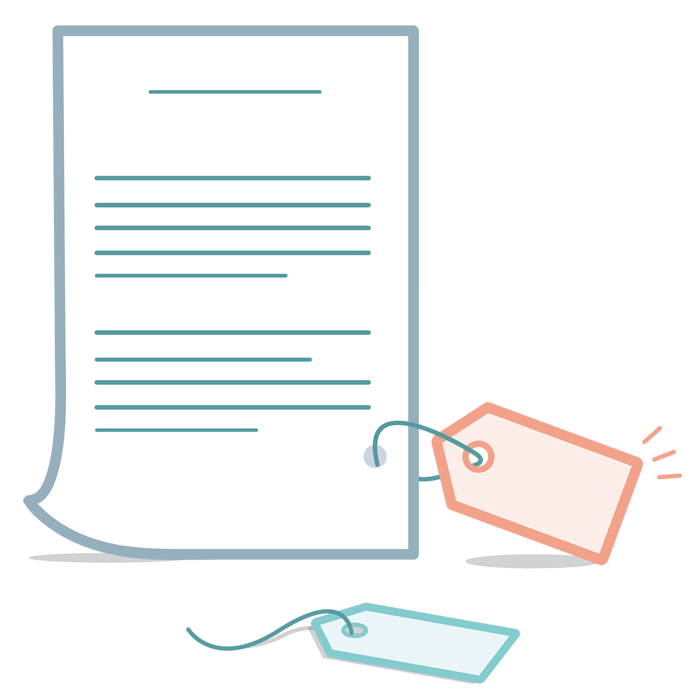Grenier : La révolution copernicienne
Hubert Grenier, La connaissance philosophique
Chapitre 3 : La révolution copernicienne
Philosopher sur la science, c’est essayer de la fonder, i.e. de déterminer quelles sont dans un être les structures
d’où la science tient la possibilité de ses opérations.
La philosophie n’est l’étude ni de ce qui est en soi ni de ce que nous faisons, ni théorie ni méthodologie : c’est à la
jonction de l’être et du faire que brille le sens. Ce que nous faisons a ses principes : « l’Être ne peut jamais être
saisi que comme l’objet d’une relation synthétique avec les principes mêmes de ce que nous faisons » (Deleuze,
Empirisme et subjectivité).
I. Platon
Au temps de Platon, la science reine, c’est l’astronomie : c’est par la totalité (le cosmos) que commence l’esprit.
Une théorie astronomique chez les Grecs consistait en une certaine façon de comprendre des apparences, par la
construction d’un modèle mathématique susceptible d’aider les mesures. Les Grecs ne demandaient pas à ce qui
nous assure l’intelligibilité du réel de passer lui-même dans les choses.
Platon ne souffrira pas la multiplicité des hypothèses (pour certains c’était le signe de la fécondité de la raison) :
ou la science n’est qu’une technique médiocre, pragmatique, destinée à nous permettre, au moyen de prévisions
convenables, de passablement nous débrouiller ; ou il doit y avoir une « bonne » hypothèse, supérieure aux
autres. C’est elle, sous la direction de normes définies par la dialectique, qui nous apprendra que ce monde relève
de la loi du meilleur et qu’il mérite l’appellation de divin.
La dialectique a pour but de sauver la science, arrachée par elle à l’empire du factice et donc du fictif. Platon
reconnaissait que la meilleure hypothèse ne peut que demeurer une hypothèse ; il ajoutait qu’elle le doit même,
car elle tire son excellence plus de l’agrément qu’elle reçoit de l’esprit que du satisfecit que lui accorde le réel. Il
serait scandaleux que la chose fût le juge de l’idée. Chez Platon la vérité de la théorie se rapporte directement à
l’esprit, indirectement à l’objet.
Le vrai ce sont les « choses », ces apparences, ce monde, mais vus à travers l’esprit, y gagnant une lumière
nouvelle, une existence supérieure, une beauté, de la valeur. La meilleure hypothèse ne peut trouver dans la
nature de quoi la promouvoir en certitude. Son support, ce ne peut être que l’intelligence ; mais cette intelligence
n’est pas elle-même comme une sorte de fait : il faut s’ouvrir à elle, il faut avoir fait régner l’harmonie en soi pour
avoir une chance de la découvrir dans le monde.
Chez Platon, l’hypothétique persiste, mais purifié, il est surmonté, il n’est pas effacé : il est an-hypothétique. Il
appartient à l’idée du bien de nous pénétrer du caractère nécessairement et heureusement hypothétique de la
pensée, de cette chose légère, aérienne, libre qui même devant le monde ne doit jamais attendre de soutien que
de soi.
II. Descartes
En matière de certitude, il conviendra d’être impitoyable : tout ou rien. L’objet du doute, ce sera le certain lui-
même. Être certain, ce n’est pas avoir des idées ingénieuses, plausibles, satisfaisantes, c’est savoir parfaitement
ce qu’on sait. La certitude est participation à l’absolu. Seules les maths (où ce que nous affirmons coïncide avec ce
que nous concevons) nous offrent cette vie et cette jouissance divines.
Certes mon savoir en maths n’est pas complet mais il est entier ; les maths ont montré aux hommes du 17e siècle
que l’on peut tout savoir d’une chose sans tout savoir de tout : un entendement fini n’en est pas moins capable
de certitude absolue.
Mais cette certitude ne s’outrepasse pas elle-même : je ne suis certain que quand je suis certain, dans l’éclat
éblouissant mais instantané d’une évidence ponctuelle. Mon entendement n’étant pas le créateur de ses objets,
ma pensée n’étant que la mesure de son savoir, non pas celle de l’être, ma certitude ne saurait me fournir le gage
de sa perpétuation. Si penser est penser ce qui est, rien ne me garantit que ce qui est sera toujours comme il est.