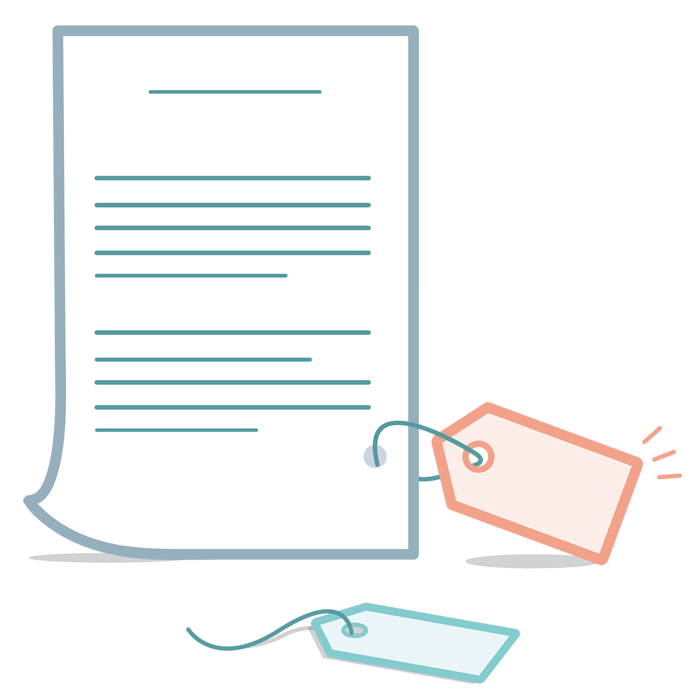Grenier : Langage et philosophie
Hubert Grenier, La connaissance philosophique
Chapitre 4 : Langage et philosophie
L’élément du savoir, c’est le langage. Rien qui soit s’il ne peut être dit. Dire, ce n’est pas simplement faire part de
quelque chose, c’est le porter à un niveau supérieur, le faire entrer dans la sphère proprement humaine. Le
langage n’est pas un commencement : le début c’est la réaction, le geste, le cri. Mais il est une origine, un
fondement. Dire : « nous avons souffert de la faim », c’est cesser de faire de la faim cet appel neutre et anonyme
de cellules en danger, c’est la désigner comme un mal humain, un fléau, un scandale. La faim se proclame,
comme les droits se déclarent.
Le langage n’est pas le privilège absolu de l’homme, mais il n’est pas une simple transmission génétique sans
intention de communication. Nous renseignant sur ce que, dans chacune de ses fonctions, l’homme partage avec
les animaux, la psychologie animale nous révèle où, à l’intérieur de l’homme et non à partir de lui, se situe le seuil
de l’humanité, à quel point une fonction passe par la mutation décisive où elle se débiologise et accède à la
sphère du sens. Parler vraiment n’est pas parler à quelqu’un (la perdrix prévient ses congénères) ; on parle pour
de bon quand on se met à parler de quelqu’un.
Le langage s’installe dans sa vérité lorsqu’il ne sert plus à une action, ne fait plus partie intégrante d’une
technique, lorsqu’il se prend lui-même pour objet ; les signes scientifiques sont limités à leur mode d’emploi et ne
renvoient à rien d’autre qu’aux opérations dont ils garantissent la maîtrise intellectuelle. Lorsqu’on parle de ce
qu’on fait, de ce qui permet de parler de tout, s’amorcent une interrogation, un questionnement étrangers aux
pseudo-discours des sciences. Les sciences ne développent pas un discours, les vérités qu’elles établissent ne
sauraient se hisser à l’universalité philosophique : se bornant à parler de ce dont elles parlent, elles ne parlent
jamais du fait qu’elles parlent et que ce sont elles qui en parlent. De même dans les formulations théologiques, le
langage, dans l’extériorité d’une révélation, s’incline devant une parole figée, oraculaire. Sans la puissance
absolue du dédoublement réflexif du langage, les plus légitimes contestations nous seraient interdites.
Les mots ne sont pas de simples substituts des choses, leur équivalent utilitaire : plus que des signaux, ce sont des
symboles, des révélateurs. Pour nous c’est dans le mot que naît la chose, que se découvre et s’anime son
expressivité. Cf. Helen Keller.
Chez les présocratiques, le langage se déroule comme l’étoffe même de la réalité, la trame éclatante où
s’unissent l’être et le penser : à travers lui, tout vient au jour, tout transparaît. Mais l’indivision ensorcelante du
dire et de l’entendre, sans distance ni recul, empêchait encore le travail de ce dur fils de la séparation, le concept.
Les Grecs exprimeront deux hypothèses : ou le langage dit intégralement l’être, donc c’est toujours la même
chose que l’on dit et alors on ne peut pas dire grand-chose de plus que « l’être est », si ce n’est peut-être « le
non-être n’est pas » ; ou bien la parole a une surabondance telle que toujours elle capte davantage d’être, il y
aura toujours quelque chose à dire , et tant qu’on ne l’aura pas dit, rien ne sera dit. D’un côté le trop court
discours parménidien, tissé de silence, de l’autre le trop long discours héraclitéen, le et cetera perpétuel.
Il y a ce que je veux dire et ce que je dis et aussi ce que je ne veux pas dire ; le sens d’une parole peut ne pas être
le même pour celui qui la profère et pour celui qui l’entend. Il existe du jeu dans le langage, et la mouvance de ses
plis autorise tous les trafics. Deux solutions : ou bien s’armer de précautions, forger des règles pour contrôler le
discours = créer une logique (qui est un protocole de méfiance), mais le problème c’est qu’elle se vide de son
contenu ontologique ; ou bien s’accommoder du jeu du langage : l’homme se taillera un immense empire, de
séduction, de tromperie, de subversion => c’est le règne absolu de la rhétorique, et surtout de la sophistique.
Quand le langage fait eau de toutes parts, l’heure est arrivée pour les sophistes. Le langage est mort. Vive le
langage : ainsi parlera le sophiste. Pour les sophistes, la source du connaître ne réside que dans le sentir => le vrai
n’a plus rien d’un miroir du réel, ce qui fait la vérité de la vérité n’est pas la vérité de la réalité. Puisque la
sensation est changement, altération, tout discours est contradictoire, il ne parle de ce qui est qu’en parlant de ce
qui n’est plus => il devient insoutenable que connaître les mots, ce soit connaître les choses. Nous ne disposons
d’aucune référence objective où nos intentions seraient susceptibles de nous accorder.
On allèguera que le sophiste est un menteur ; il répondra (car il n’est pas aisé de venir à bout du sophiste) qu’il
refuse qu’on le traite de menteur, tant que ne lui a pas été exhibée la réalité que ses propos offenseraient. Ce
n’est pas avec des mots trompeurs (car n’étant pas les miroirs exacts des choses) que l’on sera en mesure de
dénoncer la tromperie des sophistes.