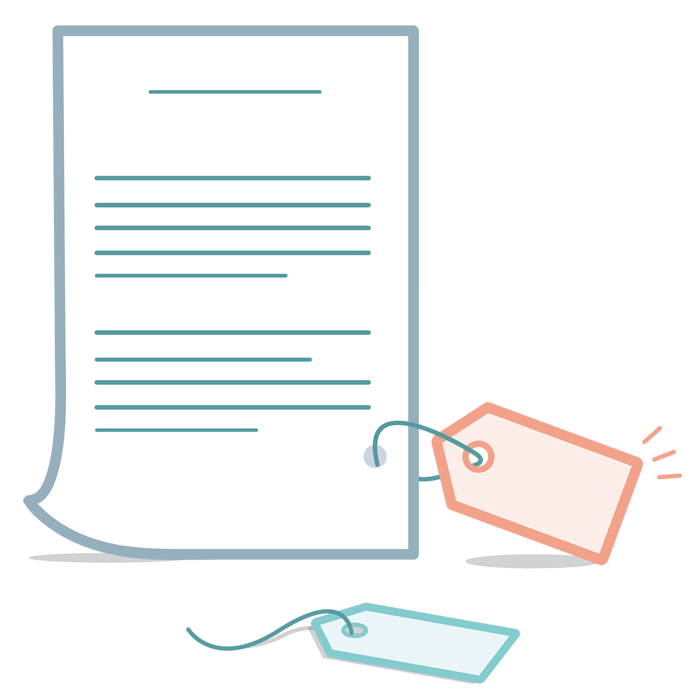Resume
Résumé L'erreur
- Établissement
- Lycée Henri-IV
Fiche du chapitre 5 du livre "La connaissance philosophique" d'Hubert Grenier (grand professeur de philosophie), chapitre portant sur le concept philosophique de "l'erreur", en se demandant si c'est une contre-vérité catastrophique ou une simple étourderie passagère.
[Montrer plus]